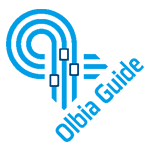NÉCROPOLE SAN SIMPLICIO
INTRODUCTION – SECTEUR 1
TEXTE
Bienvenue sur l’aire archéologique de San Simplicio. Cet audioguide a été réalisé par l’Aspo spa ; les récits audio par Audio Cultura et les textes et la supervision scientifique par Madame Letizia Fraschini.
Pour commencer le parcours de visite, rendez-vous au bout du couloir et parcourez-le en sens inverse en écoutant progressivement les contributions audio proposées. Chaque point d’intérêt est marqué par une étiquette avec le symbole des écouteurs et un numéro correspondant.
Vous pouvez également consulter un autre support de visite, à savoir les panneaux d’information présents le long du parcours.
SECTEUR 2
TEXTE
Nous nous trouvons sous la place de l’Église San Simplicio, où l’on peut observer une partie des fouilles archéologiques réalisées lors des travaux de requalification de l’espace situé face à l’église.
Les fouilles ont concerné toute la superficie de l’aire que vous êtes en train de visiter et une partie du parking adjacent. Elles mirent au jour 450 tombes, une stratification de couches témoignant de cultes pratiqués à l’extérieur de la cité et une nécropole. Ces vestiges traversent les deux mille premières années d’histoire de la ville d’Olbia, de sa naissance sous les Phéniciens jusqu’au Moyen Âge.
Le relief sur lequel se dresse aujourd’hui l’Église San Simplicio a été pendant toute l’antiquité extérieur à l’aire urbaine.
Les recherches archéologiques indiquent avec une grande clarté qu’en-dessous de l’église actuelle gît une stratification de lieux de culte antérieurs : d’abord probablement phénicien, puis grec, punique, romain et paléochrétien. À l’époque romaine, la nécropole, qui à la période punique était située au sud-ouest par rapport au lieu où nous nous trouvons, s’étendit jusqu’à occuper l’espace entourant le lieu de culte.
Il est probable qu’un lieu de culte dédié à une divinité féminine, peut-être à la déesse Ashtart (le son « sh » se prononce comme le « ch » de château), était déjà présent lors de la fondation de cité par les Phéniciens autour de 775-750 avant J.-C., étant donné la présence de fragments d’amphores phéniciennes dans les fouilles.
Le temple existait assurément pendant la phase grecque d’Olbia, lorsqu’autour de 630 avant J.-C., les Grecs de la ville de Phocée, située sur les côtes de la Turquie actuelle, remplacèrent les Phéniciens sur l’établissement urbain.
Les deux puits à eau relèvent de la phase grecque du sanctuaire, dédié à la déesse Déméter ou à la déesse Héra. Au fond de ces puits ont été déposées, au moment de leur abandon vers 600 avant J.-C., plusieurs offrandes selon un rituel sacré.
Le premier puits se trouve face à vous, avec les matériaux qui en ont été extraits : une amphore à vin de la cité grecque de Clazomènes (sur les côtes de la Turquie actuelle), un vase à vin à bouche lobée, un vase à eau avec des bandes de vernis noir, un petit vase produit avec de l’argile locale et une amphore à vin étrusque. Quant au second puits grec, nous y reviendrons plus tard.
Le sanctuaire se dressait donc sur le premier relief naturel situé hors de la zone habitée. L’appropriation symbolique d’un territoire par l’installation dans des lieux stratégiques comme les hauteurs, les gués, les promontoires, est typique des centres urbains coloniaux fondés par les Phéniciens et les Grecs en Méditerranée occidentale. Par conséquent, il est probable qu’Olbia aussi, d’abord phénicienne puis grecque, eut dès sa naissance le rang de cité.
SECTEUR 3
TEXTE
Avec la conquête carthaginoise de la Sardaigne, Olbia passa elle aussi autour de 510 avant J.-C. aux mains de Carthage. Bien que les fouilles n’aient pas permis de faire ressortir de preuves formelles, la continuité du sanctuaire à l’époque romaine rend plausible l’hypothèse de la non-interruption de son activité même pendant la phase carthaginoise.
Avec la conquête romaine de la Sardaigne autour de 238 avant J.-C., Olbia connait une période de prospérité. Nous sommes à l’époque de la République romaine et depuis 200 avant J.-C. on assiste à une explosion économique et démographique remarquable. Par conséquent, la nécropole de la ville s’agrandit, envahissant les pentes de la colline sur laquelle se trouvait le sanctuaire. Pendant cette phase, la divinité à laquelle est dédié le culte est Cérès, la Déméter des Grecs, divinité de la vie et, dans ce contexte, de la vie après la mort.
L’aire commence à se peupler de tombes à fosse, que vous pouvez apercevoir face à vous et qui, avec le passage du temps, deviennent toujours plus nombreuses.
Comme vous pouvez le constater, les tombes sont généralement accompagnées de trousseaux funéraires composés de deux bocaux, de cruches et de nombreux fragments de statuettes en terre cuite de la déesse romaine Cérès.
À partir de ce moment-là et pendant toute l’époque romaine, plus on s’approchait du temple et plus les tombes étaient nombreuses. Naturellement, dans les tombes à fosse ne sont pas exposés les ossements des personnes inhumées car ils ont été extraits pendant les fouilles et sont en cours d’étude.
SECTEUR 4
TEXTE
Face à vous vous pouvez encore apercevoir les tombes à fosse datant de la phase de la République romaine.
À l’époque impériale l’enterrement des défunts aux abords du sanctuaire se poursuivit. Il s’agit pour la plupart de tombes à fosse, à « cappuccina » ou à incinération dans des vases, tous retirés lors des fouilles et par conséquent, plus visibles aujourd’hui.
Le grand nombre de tombes, disposées à proximité les unes des autres et superposées, témoigne de la forte dévotion pour la déesse Cérès : tous désiraient être enterrés près de son temple. Les sépultures sont si nombreuses que le niveau de la nécropole se rapproche progressivement de celui des tombes à caisson d’époque impériale, dont l’une est visible face à vous. Observez le muret qui délimitait la tombe, situé sur un monceau de terre qui n’a pas été fouillé afin d’éviter de détruire le mur : si on le fouillait, il restituerait plusieurs sépultures à fosse.
Toujours face à vous, au premier plan, a été reconstruite dans un but didactique une tombe à la cappuccina, découverte en réalité sur une strate supérieure : le cadavre, avec son trousseau funéraire, était protégé par des tuiles disposées de façon à former un toit. Dans ce cas deux tuiles sont marquées du timbre de l’atelier qui les produisait, possédé par Claudia Acte, esclave libérée et maîtresse de Néron, propriétaire à Olbia justement d’une fabrique de briques et de latifundiums dont l’empereur lui avait fait don.
SECTEUR 5
TEXTE
Les vitrines renferment une sélection de matériaux issus des fouilles, restaurés grâce à la contribution de l’administration municipale d’Olbia.
Dans la première vitrine sont exposés certains récipients en céramique provenant du trousseau funéraire de tombes datant de l’empire romain. Au centre une poêle de cuisine et des vases pour boire ; en haut à droite des reproductions miniatures de vases pour boire et des récipients à onguents parfumés ; en bas à droite des récipients à onguents parfumés ; en bas à gauche deux lampes à huile ; en haut à gauche un récipient à onguents parfumés.
SECTEUR 6
TEXTE
Au premier plan à droite on aperçoit deux petites amphores placées à la verticale. Il s’agit de sépultures à incinération : le cadavre était brulé et les quelques os résiduels étaient enterrés dans des vases de formes variées. Ces dernières, comme la tombe à la « cappuccina » vu précédemment, ont été découvertes en réalité sur une strate supérieure au niveau actuel, et placées ici à des fins didactiques.
À gauche face à vous, près du mur du fond du site, on aperçoit le deuxième puits appartenant à la phase grecque d’Olbia, illuminé par une lumière blanche interne. Comme dans le premier cas, au fond ont été découverts des vases déposés selon un rituel sacré, désormais exposés à côté du puits : il s’agit de deux grandes amphores à huile ou à vin de Corinthe, dont l’une a été entièrement recomposée, d’une amphore à vin de l’île de Chios (située face aux côtes de la Turquie actuelle) avec les bandes de peinture rouge typiques, et d’un vase pour servir le vin.
À gauche du puits se trouvent à nouveau des tombes à fosse datant de la République romaine, et au niveau supérieur une portion d’une tombe à « cappuccina » datant de l’empire romain, coupée dans un deuxième temps par un mur.
SECTEUR 7
TEXTE
Dans cette vitrine sont exposés plusieurs objets appartenant au trousseau funéraire de tombes datant de l’empire romain : une lame de plomb gravée de figures humaines schématiques, les clous des semelles de deux chaussures et, provenant de tombes d’enfants, de petites poupées avec des membres mobiles et deux sifflets en forme de poule et de colombe. Les statuettes proviennent en revanche des tombes à fosse datant de la République romaine vues précédemment.
SECTEUR 8
TEXTE
Nous savons que le temple de Cérès fut restructuré autour de 60/70 après J.-C. par Claudia Acte, la maîtresse à laquelle Néron avait fait don de vastes propriétés dans le territoire d’Olbia et qui était très dévouée à la déesse. Cette intervention est attestée par l’inscription placée sur l’architrave du temple, découverte au Moyen Âge, très probablement pendant les travaux de construction de l’Église San Simplicio, et aussitôt transportée à Pise, où elle est toujours conservée.
Quelques années plus tard, sous le règne des empereurs de la dynastie des Flaviens, à savoir Vespasien, Titus et Domitien, l’accès au sanctuaire fut rendu monumental grâce à la construction de deux longs murs parallèles encore apparents, qui flanquaient la rampe d’accès au temple. Si le mur du fond de l’aire archéologique n’existait pas, dans l’espace encadré par les deux murs parallèles il serait possible de distinguer, en hauteur, l’entrée de l’Église San Simplicio, parfaitement dans l’axe avec les murs romains. Cet alignement précis de l’église avec les murs romains est une preuve supplémentaire du fait qu’elle a été élevée sur des lieux de culte antérieurs.
SECTEUR 9
TEXTE
Le sol de la rampe d’accès, dont il reste encore quelques traces, réalisé sous la dynastie des Flaviens, recouvrait deux tombes monumentales plus anciennes, peut-être puniques, malheureusement déjà pillées pendant l’antiquité, constituées de grandes dalles de pierre à droite du long mur de gauche.
Après 313 après J.-C., avec la diffusion progressive du christianisme, le culte de la déesse Cérès fut remplacé dans le sanctuaire par celui du martyr Simplicio.
Les siècles du Haut Moyen Âge, de 450 à environ 1000 après J.-C., correspondent à une période de grande crise pour Olbia, et par conséquent durant cette phase les sépultures sont peu nombreuses et très pauvres : il s’agit de tombes à fosse voutées bordées de quelques pierres et dénuées de trousseau funéraire.
Pour assister à la renaissance culturelle et économique de la ville il faut attendre la période appelée en Sardaigne « période des Judicats », lorsque l’île était divisée en quatre royaumes, dits Judicats, et que Olbia était la capitale de l’un d’entre eux : celui de Gallura.
Pendant cette phase, nous sommes en 1100 après J.-C., fut érigée l’église romane San Simplicio, toujours visible sur la place située au-dessus du site archéologique.
Pour la construction de l’église fut réalisé un four à chaux, qui correspond à la structure en maçonnerie circulaire située en face de vous, placée entre les deux murs romains qui marquaient l’accès au sanctuaire et illuminée par une lumière interne blanche. Ce four fut nécessaire pour la construction de l’église et pour des interventions ultérieures menées par l’autorité ecclésiastique.
Le four fut réalisé à cet emplacement car il correspondait au niveau le plus bas, étant donné qu’il s’agissait de la rampe d’accès au sanctuaire, alors qu’au-delà le niveau du sol était plus élevé en raison de l’ajout continu de tombes au cours des siècles précédents.
La période des Judicats est attestée également par deux tombes.
L’une, en dalles de granit, est placée entre le four à chaux et la base du mur du fond de l’aire archéologique, entre les deux longs murs romains qui marquaient l’accès au sanctuaire, illuminée par une lumière interne blanche.
L’autre est constituée d’un petit mur de brique au-dessus du long mur romain de gauche ; puisqu’elle effleure presque la couverture de l’aire archéologique, on peut observer seulement une partie du mur en brique à l’endroit où le mur romain croise la paroi du fond du site.
SECTEUR 10
TEXTE
Dans cette vitrine sont exposés plusieurs récipients en verre provenant de tombes de l’empire romain. Au centre, des fioles servant à contenir des onguents parfumés et les fragments d’une petite cruche ; en haut à droite des fragments de récipients à onguents parfumés en forme de pomme de pin ; en bas à droite les fragments d’une petite cruche ; en bas à droite de petits vases pour boire ; en haut à gauche un verre et une fiole.
SECTEUR 11
TEXTE
Dans cette vitrine sont exposés plusieurs bijoux et ornements personnels provenant du trousseau funéraire de tombes datant de l’empire romain, deux récipients en plomb servant à contenir de petits objets ou des onguents cosmétiques et, au centre, deux miroirs en bronze.
Le trousseau funéraire composé d’anneaux et de bijoux, provenant d’une tombe surnommée pour cette raison par convention « tombe du Seigneur des Anneaux », présente un intérêt tout particulier. Il contient notamment une bague montée en argent avec une pierre de cornaline, sur laquelle est gravée une figure humaine, et un disque d’argent avec la figure équestre de l’empereur Constantin.
SECTEUR 12
TEXTE
Ici sont visibles deux tombes à caisson avec leur trousseau funéraire et deux tombes à la « cappuccina » datant de l’empire romain. Ces dernières n’ont pas été fouillées afin de montrer au visiteur dans quel état elles se trouvaient au moment de leur découverte. Dans le monceau de terre non fouillé, sur lequel se trouvent les quatre tombes, se cachent sans doute plusieurs autres sépultures à fosse.
Les tuiles placées sur la paroi gauche de l’aire archéologique sont les mieux conservées parmi celles qui recouvraient les tombes à la « cappuccina » découvertes.
Comme vous l’aurez remarqué, la compréhension du site n’est pas toujours facile car sont visibles en même temps des pièces, des tombes et des structures de maçonnerie qui s’étendent sur un arc temporel de près de 1700 ans. Toutefois, la Direction Archéologique, des Beaux-Arts et du Paysage et la Commune d’Olbia, avec les fonds de la Communauté Européenne et de la Région Sardaigne, ont décidé de rendre ce site archéologique accessible non seulement pour son caractère spectaculaire et parce qu’il témoigne de toute l’histoire antique de la ville, mais aussi afin que les habitants et les visiteurs se rendent compte concrètement du fait qu’à quelques centimètres en sous-sol gît toute une cité antique, que chaque opération d’excavation, même minimale, met en péril.
SECTEUR 13
TEXTE
La visite du site est terminée mais il nous reste d’autres informations à vous transmettre.
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à visiter l’Église San Simplicio, située sur la place située au-dessus de ce site archéologique. Vous pourrez ainsi recueillir deux autres preuves majeures de l’existence de lieux de culte plus anciens cachés en sous-sol. Les trois nefs sont séparées par deux rangées de colonnes alternées de piliers à base carrée ou rectangulaire. Vous remarquerez facilement que la base des piliers ne repose pas directement sur le pavement de l’église mais sur des blocs en saillie, qui appartiennent donc à un édifice monumental antérieur. En outre, l’entrée de la grande majorité des églises de ce type en Sardaigne, et ailleurs, est orientée vers l’ouest. Or dans notre cas elle est orientée vers l’est, comme les temples grecs et romains dont elle a conservé l’orientation, ayant justement été édifiée sur les fondations d’un lieu de culte païen.
Nous vous invitons pour finir à visiter le Musée Archéologique situé sur le bord de mer et ses extraordinaires épaves de navires romains ainsi que les autres monuments ouverts au public du territoire d’Olbia : les nuraghes de Cabu Abbas, le puits sacré nuragique de Sa Testa, la tombe des géants de Pedres, les murs puniques de la via Torino, l’îlot d’habitation punique et les piliers de l’aqueduc romain de la via Nanni, l’aqueduc romain de la via Mincio, le château de Pedres, l’église du XIXe siècle de la via Antonio Spano.
Nous vous remercions de votre visite.